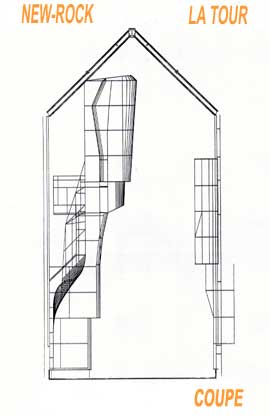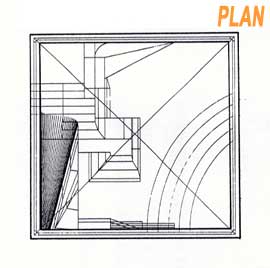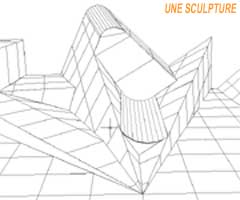

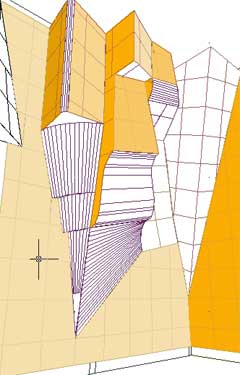
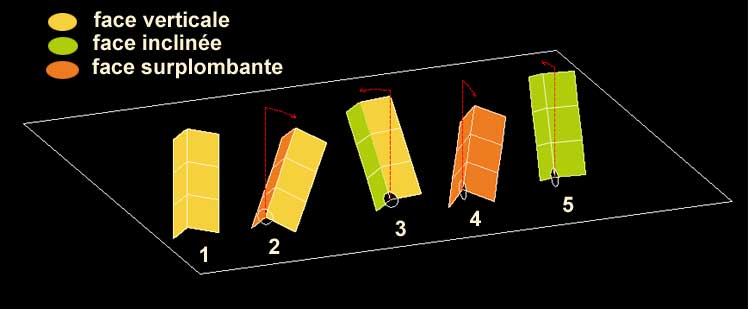
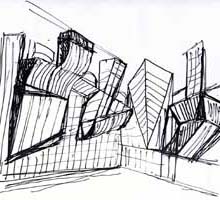

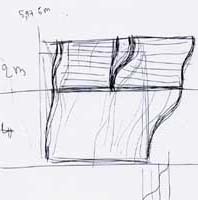

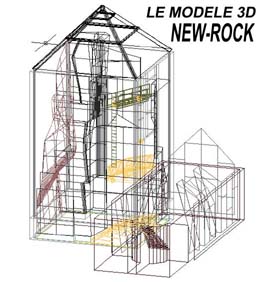

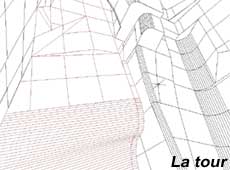
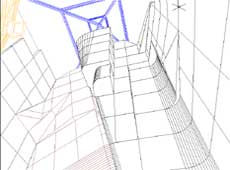
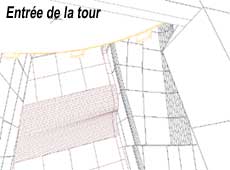
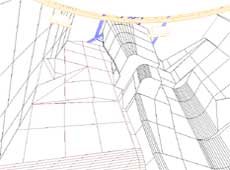
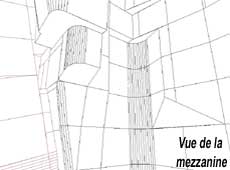

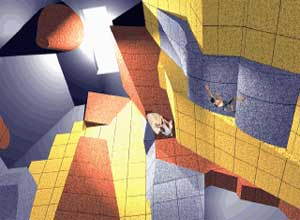

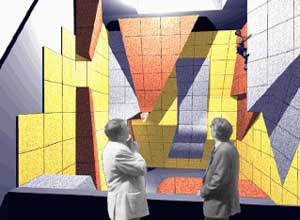
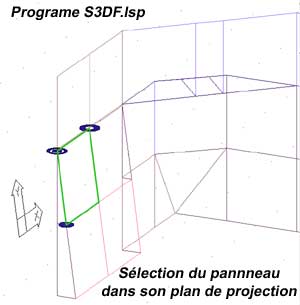
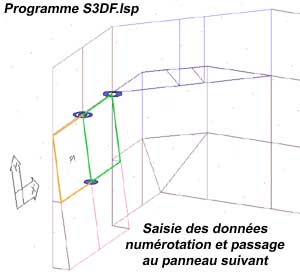
![]() Les
formes courbes sont réalisées par une superposition de couche de multiplex
collées sur des gabarits (technique des bateaux). La difficulté consiste à
tracer les gabarits.
Les
formes courbes sont réalisées par une superposition de couche de multiplex
collées sur des gabarits (technique des bateaux). La difficulté consiste à
tracer les gabarits.
![]() Pour
les arcs de cercles, il suffit
de connaître le rayon.
Pour
les arcs de cercles, il suffit
de connaître le rayon.
![]() Pour
les ellipses, il faut connaître
le petit et le grand cercle et tracer le gabarit avec une ficelle d'une longueur
égale au grand axe, à partir des foyers (voir croquis) .
Pour
les ellipses, il faut connaître
le petit et le grand cercle et tracer le gabarit avec une ficelle d'une longueur
égale au grand axe, à partir des foyers (voir croquis) .
![]() Pour
les formes côniques, les
gabarits sont constitués d'une succession d'ellipses dont on peut trouver
les dimensions des axes par un tracé des projections.
Pour
les formes côniques, les
gabarits sont constitués d'une succession d'ellipses dont on peut trouver
les dimensions des axes par un tracé des projections.
![]() Pour
les vagues, le problème est plus
complexe. La vague pour être réalisable, doit être générée par une forme développée,
c'est à dire engendrée par des lignes horizontales, dans ce cas seulement
il est possible de
Pour
les vagues, le problème est plus
complexe. La vague pour être réalisable, doit être générée par une forme développée,
c'est à dire engendrée par des lignes horizontales, dans ce cas seulement
il est possible de
"dérouler" les feuilles de multiplex sur les gabarits. La réalisation d'un
modèle informatique de la vague en forme développée permet de déterminer les
différents profils des gabarits.
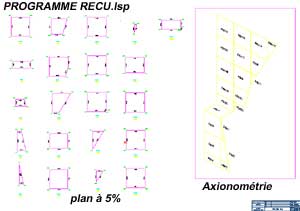
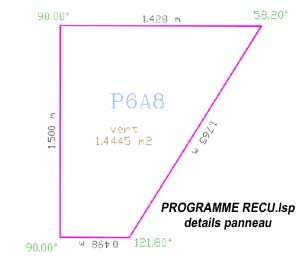
![]() QUELQUES
PROJETS ET RÉALISATIONS DU DÉBUT :
QUELQUES
PROJETS ET RÉALISATIONS DU DÉBUT :
![]() Pratiquant
la spéléologie et l'escalade depuis 1967 et diplômé en architecture en 1975,
j'ai eu l'occasion de participer activement à la naissance de l'escalade
sur structure artificielle.
Pratiquant
la spéléologie et l'escalade depuis 1967 et diplômé en architecture en 1975,
j'ai eu l'occasion de participer activement à la naissance de l'escalade
sur structure artificielle.
![]() 1969
TOUR DE MONT SUR MEUSE : Avec les guides du Centre Routier Spéléo, montage
d'une tour en bois de 11m de haut pour la pratique des techniques spéléo
1969
TOUR DE MONT SUR MEUSE : Avec les guides du Centre Routier Spéléo, montage
d'une tour en bois de 11m de haut pour la pratique des techniques spéléo
(architecte Y.Peters)
![]() 1975
PROJET D'UNE TOUR ÉCOLE BOIS ET BÉTON à Mont sur Meuse (Projet
Charlemagne)
1975
PROJET D'UNE TOUR ÉCOLE BOIS ET BÉTON à Mont sur Meuse (Projet
Charlemagne)
![]() 1984
ESQUISSE POUR LE " POOL MONTAGNE -SPELEO-RANDONNEE " du salon des sports 85
à Bruxelles
1984
ESQUISSE POUR LE " POOL MONTAGNE -SPELEO-RANDONNEE " du salon des sports 85
à Bruxelles
![]() 1986
Création de la société ALPI-IN avec P.Dannens et M.Van Slip. Première société
belge de construction de mur d'escalade
1986
Création de la société ALPI-IN avec P.Dannens et M.Van Slip. Première société
belge de construction de mur d'escalade
![]() Mise
au point du concept des panneaux multi-perforés avec inserts en acier zingué
tous les 20 cm permettant le montage et le démontage rapide des prises en
résine.
Mise
au point du concept des panneaux multi-perforés avec inserts en acier zingué
tous les 20 cm permettant le montage et le démontage rapide des prises en
résine.
![]() Mise
au point du mur mobile Alpi-in , composé de deux pans à inclinaison variable
actionné par des vis sans fin Hauteur 6m Largeur 3m
Mise
au point du mur mobile Alpi-in , composé de deux pans à inclinaison variable
actionné par des vis sans fin Hauteur 6m Largeur 3m
![]() 1987
Mise au point du principe des prises en creux pour ALPI-IN
1987
Mise au point du principe des prises en creux pour ALPI-IN
![]() 1987
SALLE NEW-ROCK à Bruxelles (la petite salle) recherche des premières formes
particulières, pilier surplombant, dalle surplomb à facettes …. La 2 ème salle
privée qui voit le jour en Belgique.
1987
SALLE NEW-ROCK à Bruxelles (la petite salle) recherche des premières formes
particulières, pilier surplombant, dalle surplomb à facettes …. La 2 ème salle
privée qui voit le jour en Belgique.
![]() 1988
Etude pour ALPI-IN d'un mur extérieur en résine dans le parc de la Coccinelle
pour la mairie de Salonel à Saleux. Hauteur 15m largeur 6m. Le tracé des "
tranches" est réalisé par dessin assisté.
1988
Etude pour ALPI-IN d'un mur extérieur en résine dans le parc de la Coccinelle
pour la mairie de Salonel à Saleux. Hauteur 15m largeur 6m. Le tracé des "
tranches" est réalisé par dessin assisté.
![]() 1988
Esquisse d'un mur Alpi-in pour une compétition internationale. Représentation
en perspective par dessin assisté.
1988
Esquisse d'un mur Alpi-in pour une compétition internationale. Représentation
en perspective par dessin assisté.
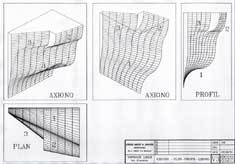
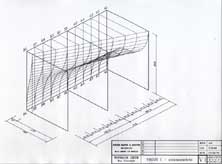
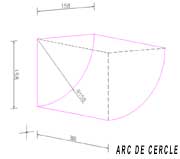
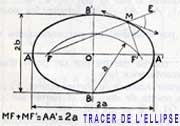
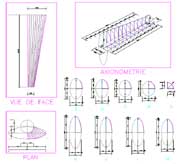
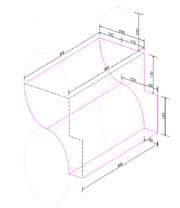


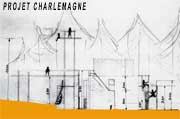
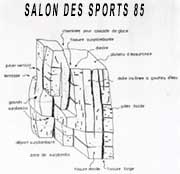






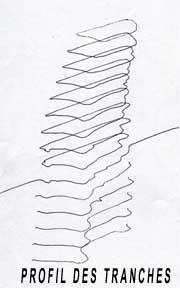
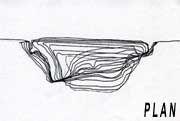


LE PROJET
L'élément de base du projet est un pilier déversant de 4.5m, semblable à
un éperon rocheux, composé d'une face très déversante continue et d'une autre
composée de face verticale ou légèrement déversante entrecoupée de petit toits.
Le sommet du pilier se termine par un cône se raccordant à la face
très déversante d'un côté et à une face légèrement déversante
de l'autre. Cette forme permet des multiples nuances dans l'escalade par simple
déplacement latéral de quelques cm.
Cet éperon s'appuie à gauche sur une dalle perpendiculaire composée d'une
"vague" à profil variable (forme développée) et de dalles verticales
à petits toits obliques et horizontaux.
Ces deux éléments sont séparés par une large fissure qui se transforme en
grotte et cheminée en partie supérieure. La grotte était prévue à l'origine
pour être une fenêtre sur le mur extérieur grimpable. Le pilier se raccorde
à droite par un jeu de dièdres cylindriques entrecoupés de petits toits. La
dalle à "vague" se raccorde à gauche par un élément très controversé à l'époque
et qui est devenu maintenant un classique "Le diamant" dalle triangulaire
inclinée à la sortie d'un petit toit, permettant des passages d'adhérence
extrême ! ! !